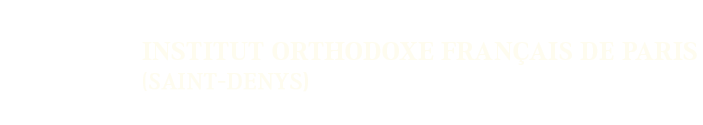Enseignements du 1er semestre
Séance d'ouverure : samedi 11 octobre 2025 à 17h15 dans les locaux de l'Institut : salle Pierre Kovalevsky, 96 boulevard Auguste Blanqui - 75013 Paris (Métro Glacière).
1er cours : lundi 13 octobre 2025 à 20h15, dans les locaux habituels de l'Institut et en visioconférence.
Cours oraux, en soirée, de 20h15 à 22h15.
1er semestre 2025-26 (mise à jour du 8août 2025)
1er semestre : du lundi 13 octobre au mercredi 17 décembre 2025 inclus et du lundi 5 janvier 2026 au vendredi 6 février 2026 inclus.
Le 2nd semestre débute le lundi 9 février 2026.
EN ALTERNANCE
LUNDI semaine A
Mgr Benoît, évêque de Pau2 disciplines par soirée, 15 soirées.
- Initiation à la dogmatique de l’Église orthodoxe (1 heure)
- Histoire moderne de l’Église catholique orthodoxe de France (1 heure)
LUNDI semaine B
Diacre Luc Bertrand-HardyCours annuel, 2h/cours, 15 soirées.
- Regard sur la destinée de l’humanité, par saint Jean de Paris
MERCREDI
Recteur Hubert OrdronneauCours annuel, 2 disciplines par soirée, 2 x 1h/cours, 15 soirées.
- Droit canon : Les Constitutions apostoliques
- Patrisitique : Saint Augustin, Les Confessions
MERCREDI
Prêtre Bruno TardifCours annuel, 2h/cours, 11 soirées.
- Thème : Histoire de l’Église orthodoxe : des origines à la fin de l'Empire Romain d'Occident (476)
COURS ANNUELS
MARDI
Mgr Philippe, évêque de la Charité-sur-LoireUn mardi par mois, 2h/cours, 8 soirées.
- Initiation à la Bible
Un mardi par mois, 2h/cours, 5 soirées.
- Angélologie
MERCREDI
Bertrand VergelyUn mercredi par mois, 2h/cours, 5 soirées.
- Philosophie
JEUDI
Alain MarchandLe 2ème jeudi du mois, cours annuel, 2h/cours, 8 soirées.
- Exégèse du Nouveau Testament / Commentaires sur la 1ère épître de saint Paul aux Corinthiens
Le 4ème jeudi du mois, 2h/cours, 5 soirées.
- Théologie et philosophie
VENDREDI
Recteur Hubert OrdronneauCours annuel, 2h/cours par quinzaine, 15 soirées.
- Initiation au grec biblique
- Réservé aux étudiants de 2e année
CONFERENCES
Conférences 2025-26
Programme en élaborationConférences de fin de semaine
Prêtre Vincent Tanazacq4 heures par week-end, 4 week-ends.
Vendredi soir à 20h30 + lendemain, samedi à 14h30
- Gestuelle liturgique. La célébration détaillée des mystères.
Brochure Cursus Cours Organigramme Calendrier Incription aux cours